
 En route ce matin vers cette ancienne bastide du Tarn et Garonne fondée en 1144 par le Comte de Toulouse Alphonse Jourdain, « Montalba », le Mont Blanc, nom qui deviendra, Montauban.
En route ce matin vers cette ancienne bastide du Tarn et Garonne fondée en 1144 par le Comte de Toulouse Alphonse Jourdain, « Montalba », le Mont Blanc, nom qui deviendra, Montauban.
Quelques rappels historiques retraçant brièvement l’histoire de la ville.
Située entre Toulouse et Cahors, la bastide devient rapidement une ville importante. De l’époque médiévale, ne subsistent qu’une salle gothique du château comtal, l’église Saint Jacques et son magnifique clocher octogonal à base fortifiée que nous contournerons pour rejoindre la Place Nationale, remarquable place à double travées d’arcades.
Au début du XIV°, Montauban est en pleine expansion économique. La guerre de 100 ans et la Peste Noire vont freiner brutalement cet essor.
Pendant les guerres de religion, la ville, fief de la résistance protestante, affirme son caractère face à la puissance régalienne catholique, mais en 1629, Richelieu y rétablit le culte catholique et les Montalbanais doivent se soumettre.
A la Révolution, la bastide bénéficie d’un nouvel élan avec le développement industriel et en 1808 devient chef lieu d’un département nouvellement créé par Napoléon, le Tarn et Garonne.
Si au cours du XIX° le déclin industriel ternit son rayonnement, elle reste cependant un centre administratif et agricole. Ville d’art et d’histoire, Montauban est surtout connu pour être la ville natale d’Ingres et de Bourdelle.

 Nous arrivons d’ailleurs devant les portes du musée « Ingres-Bourdelle » baptisé du nom des deux enfants prodiges du pays. Avec notre guide, Irène, nous découvrons cet immense édifice. Ouvert en 1851, le musée s’agrandira progressivement dans l’ancien palais épiscopal construit au XVII° par l’évêque de Montauban, Pierre III de Berthier. De la brique rose de la façade, sur le cadre surmontant le portail de l’escalier d’honneur, se détache une pierre blanche sculptée aux armes de l’évêque : le taureau furieux symbolise la puissance …
Nous arrivons d’ailleurs devant les portes du musée « Ingres-Bourdelle » baptisé du nom des deux enfants prodiges du pays. Avec notre guide, Irène, nous découvrons cet immense édifice. Ouvert en 1851, le musée s’agrandira progressivement dans l’ancien palais épiscopal construit au XVII° par l’évêque de Montauban, Pierre III de Berthier. De la brique rose de la façade, sur le cadre surmontant le portail de l’escalier d’honneur, se détache une pierre blanche sculptée aux armes de l’évêque : le taureau furieux symbolise la puissance …
Jusqu’en 1869 le musée ne dispose pas de l’ensemble du bâtiment, l’hôtel de ville occupant toujours une partie de l’édifice. Après de nombreux travaux d’aménagement, le musée sera inauguré dans sa nouvelle présentation le 5 octobre 1913.
 Franchissons les marches du somptueux escalier en pierre conduisant au premie
Franchissons les marches du somptueux escalier en pierre conduisant au premie r étage à la salle Ingres où Irène retrace la vie du peintre devant deux tableaux représentant « Ingres père et Ingres fils ».
r étage à la salle Ingres où Irène retrace la vie du peintre devant deux tableaux représentant « Ingres père et Ingres fils ».
Bien qu’il y soit né le 29 Août 1780 et qu’il ait donné son surnom à la ville, « la Cité Ingres », Ingres ne vécut à Montauban que ses onze premières années. Elève de son père, puis de Joseph Roques à l’école des Beaux Arts de Toulouse, dès 1797 Ingres étudie à Paris sous la direction de Jacques-Louis David. Il entre à l’Ecole Nationale de peinture, de sculpture et d’architecture en 1799. Sa première participation au prix de Rome se solde par un échec. La critique lui reproche » la raideur de ses drapés »… Ingres persévère et se représente, avec succès cette fois-ci, en 1801 mais doit attendre cinq ans avant de rejoindre l’Italie. Les quatre années de pensionnat à la villa Médicis, de 1806 à 1810, seront les plus fécondes : nus, dessins et portraits. Séduit par l’Italie, amoureux de ses paysages et de sa lumière, c’est là qu’il peignit ses premières grandes compositions mythologiques, historiques ou religieuses. Directeur de l’académie de France à Rome de 1835 à 1841 il enseigne de nombreux jeunes artistes français.
 Notre guide ponctue notre parcours de nombreux arrêts en détaillant certaines toiles.
Notre guide ponctue notre parcours de nombreux arrêts en détaillant certaines toiles.
« Jésus remettant les clefs du Paradis à Saint-Pierre », sa première commande officielle datée de 1820. Dans cette représentation, Ingres a ajouté la surprenante silhouette de Judas cachée dans l’ombre. La figure du traître n’aurait pas dû apparaître, en toute logique, puisque la scène est antérieure à la Résurrection. Mais elle renforce l’idée du libre-arbitre de chaque homme face au difficile chemin qui conduit au divin … Irène souligne que nous découvrirons au cours de la visite « que le peintre truffe son oeuvre de bizarreries ». Elle nous fait remarquer les figures des apôtres dérivant directement de Raphaël. Le peintre portait à Raphaël une véritable vénération et passa une grande partie de son temps à copier ce maître de la Renaissance : il tenta de se réapproprier le style de Raphaël allant jusqu’à le citer dans sa propre peinture en reprenant subtilement un détail, un costume, une posture, un décor de colonne.
 En 1820 Ingres quitte Rome pour Florence où il peint dans son grand atelier de la Via Delle Belle Donne « Le voeu de Louis XIII, commandé par l’Etat français pour la cathédrale de Montauban… C’est le succès remporté par cette ouvre au salon de 1824 qui amena Ingres à revenir à Paris. Après des années d’expatriation à Rome, son talent est enfin reconnu par les critiques. En 1826, le roi Charles X lui délivrera même la légion d’honneur.
En 1820 Ingres quitte Rome pour Florence où il peint dans son grand atelier de la Via Delle Belle Donne « Le voeu de Louis XIII, commandé par l’Etat français pour la cathédrale de Montauban… C’est le succès remporté par cette ouvre au salon de 1824 qui amena Ingres à revenir à Paris. Après des années d’expatriation à Rome, son talent est enfin reconnu par les critiques. En 1826, le roi Charles X lui délivrera même la légion d’honneur.
 Un bref coup d’oeil sur les nombreuses récompenses obtenues par l’artiste avant de découvrir l’immense toile destinée à décorer la chambre à coucher de Napoléon Bonaparte au palais Quirinal à Rome, « le songe d’Ossian » daté de 1813, toile disparue après la chute de l’empereur puis retrouvée par le peintre lors d’un voyage en Italie. Ingres n’eut alors de cesse de retoucher cette oeuvre pendant 32 ans, s’appliquant surtout à modifier la chevelure d’Ossian…
Un bref coup d’oeil sur les nombreuses récompenses obtenues par l’artiste avant de découvrir l’immense toile destinée à décorer la chambre à coucher de Napoléon Bonaparte au palais Quirinal à Rome, « le songe d’Ossian » daté de 1813, toile disparue après la chute de l’empereur puis retrouvée par le peintre lors d’un voyage en Italie. Ingres n’eut alors de cesse de retoucher cette oeuvre pendant 32 ans, s’appliquant surtout à modifier la chevelure d’Ossian…
L’observation de trois académies révèlent le cheminement de la pensée de l’artiste : avant de peindre, il réalise de nombreux dessins préparatoires, toujours à la poursuite de la forme parfaite, « de la courbe idéale ». Chaque détail est minutieusement étudié. Il disait : » le dessin est la probité de l’art ».
Irène s’arrête devant le tableau « Roger délivrant Angélique », Angélique, princesse prisonnière d’un monstre marin est sauvée par l’intervention d’un chevalier chevauchant un hippogriffe, une créature mi-aigle mi-cheval. Ce tableau peint en 1841 ne fut pas bien accueilli, les critiques dénigrant « l’Angélique goitreuse de Monsieur Ingres « …
Nous voici maintenant devant le portrait de Caroline Gonse, l’épouse d’un conseiller à la cour d’appel de Rouen. Dans ce tableau daté de 1852, on retrouve tout le brio du peintre dans la description des étoffes, des rubans, des bijoux ainsi que dans l’association étonnante des couleurs. Portraitiste le plus côté de son époque, Ingres était très sollicité. Madame Moitessier attendra douze ans son portrait..
 Le tableau « Jésus parmi les Docteurs » aux surprenantes couleurs vives ! Commencé en 1845, achevé en 1862. Lorsque Ingres reprend le tableau en 1862, il y introduit certains de ses proches : le docteur en vert à droite a pour modèle Théophile Gautier, poète et critique d’art…L’oeuvre avait été commandée par le roi Louis Philippe et la reine Marie-Amélie de Bourbon-Siciles pour la chapelle du château de Bizy en hommage à leur fils mort en 1842. Ingres met symboliquement l’accent sur la vierge venant chercher son enfant en référence à la reine Marie-Amélie qui vient de perdre son fils ainé…
Le tableau « Jésus parmi les Docteurs » aux surprenantes couleurs vives ! Commencé en 1845, achevé en 1862. Lorsque Ingres reprend le tableau en 1862, il y introduit certains de ses proches : le docteur en vert à droite a pour modèle Théophile Gautier, poète et critique d’art…L’oeuvre avait été commandée par le roi Louis Philippe et la reine Marie-Amélie de Bourbon-Siciles pour la chapelle du château de Bizy en hommage à leur fils mort en 1842. Ingres met symboliquement l’accent sur la vierge venant chercher son enfant en référence à la reine Marie-Amélie qui vient de perdre son fils ainé…
De salle en salle, nous arrivons à la salle dédié à Armand Cambon, peintre et ami d’Ingres qui deviendra en 1863 le premier directeur du musée Ingres-Bourdelle et à la mort du peintre son exécuteur testamentaire.
 Changement de niveau : dans une salle aux plafonds somptueusement ornés est présentée la collection des dessins d’Ingres, dont son premier dessin daté de 1789. C’est la plus grande collection du monde consacrée à l’artiste.
Changement de niveau : dans une salle aux plafonds somptueusement ornés est présentée la collection des dessins d’Ingres, dont son premier dessin daté de 1789. C’est la plus grande collection du monde consacrée à l’artiste.
 On ne peut contempler les oeuvres du dernier étage dédié aux Nus et aux différentes interprétations liées à ce genre artistique sans penser au tableau peint par Ingres en 1814, « La Belle Odalisque ». Un Nu grandeur nature, représentation imaginaire de l’esclave d’un sultan ottoman. Ingres concentre ses soins à la pureté des lignes s’émancipant de toute vérité anatomique. Une femme nue vue de dos selon l’archétype de l’époque. Une femme à l’attitude sereine, à la peau veloutée, offerte aux regards, se prélassant de façon lascive… Un dos particulièrement long…trois vertèbres supplémentaires ! Un angle peu naturel formé par la jambe gauche ! Ces déformations sont voulues, l’artiste préférant volontairement sacrifier la vraisemblance à sa vision de la beauté : il ne cherche pas à rendre compte de la réalité anatomique du Nu, mais soumet son modèle à sa manière. Ses croquis de préparation sont pourtant parfaits, la déformation n’intervient que dans la mise en oeuvre finale.
On ne peut contempler les oeuvres du dernier étage dédié aux Nus et aux différentes interprétations liées à ce genre artistique sans penser au tableau peint par Ingres en 1814, « La Belle Odalisque ». Un Nu grandeur nature, représentation imaginaire de l’esclave d’un sultan ottoman. Ingres concentre ses soins à la pureté des lignes s’émancipant de toute vérité anatomique. Une femme nue vue de dos selon l’archétype de l’époque. Une femme à l’attitude sereine, à la peau veloutée, offerte aux regards, se prélassant de façon lascive… Un dos particulièrement long…trois vertèbres supplémentaires ! Un angle peu naturel formé par la jambe gauche ! Ces déformations sont voulues, l’artiste préférant volontairement sacrifier la vraisemblance à sa vision de la beauté : il ne cherche pas à rendre compte de la réalité anatomique du Nu, mais soumet son modèle à sa manière. Ses croquis de préparation sont pourtant parfaits, la déformation n’intervient que dans la mise en oeuvre finale.
Ingres meurt le 14 janvier 1867. Il lègue à la ville, outre son fameux violon, l’ensemble des oeuvres de son atelier dont plus de 4500 dessins autographes qui constituent la richesse essentielle du musée. Le premier don de 1851 s’ enrichit d’une trentaine de tableaux et de plusieurs dizaines de portefeuilles contenant gravures et photographies anciennes, calques, copies d’élèves et études diverses..
 Inoubliable visage que celui d’Ingres sculpté par Bourdelle en 1908! Le sculpteur n’avait que six ans quand le peintre mourut mais il lui vouait une admiration sans borne et s’enorgueillissait de partager ses origines montalbanaises. On voit ici la force du regard perçant au milieu d’un visage crispé par une intense réflexion. Posé sur l’épaule gauche, un drapé souligne la nudité du peintre représenté comme une figure héroïque de l’antiquité, sans aucun apprêt…
Inoubliable visage que celui d’Ingres sculpté par Bourdelle en 1908! Le sculpteur n’avait que six ans quand le peintre mourut mais il lui vouait une admiration sans borne et s’enorgueillissait de partager ses origines montalbanaises. On voit ici la force du regard perçant au milieu d’un visage crispé par une intense réflexion. Posé sur l’épaule gauche, un drapé souligne la nudité du peintre représenté comme une figure héroïque de l’antiquité, sans aucun apprêt…
 Nous voici dans la partie du musée qui rend hommage à Emile-Antoine Bourdelle, l’un des trois grands sculpteurs du XX° né le 30 octobre 1861. De famille modeste, son père est menuisier ébéniste, sa mère fille de tisserand, Emile préfère le dessin à l’étude, ce que comprend son instituteur… Dès 1874, initié à l’ébénisterie par son père, le jeune garçon réalise ses premiers ouvrages et obtient une bourse d’étude à l’Académie des Beaux Arts de Toulouse. C’est là, que pendant ses années de formation il découvre la musique du compositeur allemand Ludwig Van Beethoven. Il réalisera quelques quatre vingt sculptures de la figure obsédante du musicien auquel il s’identifiait. La légende voudrait que tout jeune, Bourdelle ait été frappé de sa ressemblance avec un portrait de Beethoven.
Nous voici dans la partie du musée qui rend hommage à Emile-Antoine Bourdelle, l’un des trois grands sculpteurs du XX° né le 30 octobre 1861. De famille modeste, son père est menuisier ébéniste, sa mère fille de tisserand, Emile préfère le dessin à l’étude, ce que comprend son instituteur… Dès 1874, initié à l’ébénisterie par son père, le jeune garçon réalise ses premiers ouvrages et obtient une bourse d’étude à l’Académie des Beaux Arts de Toulouse. C’est là, que pendant ses années de formation il découvre la musique du compositeur allemand Ludwig Van Beethoven. Il réalisera quelques quatre vingt sculptures de la figure obsédante du musicien auquel il s’identifiait. La légende voudrait que tout jeune, Bourdelle ait été frappé de sa ressemblance avec un portrait de Beethoven.
En 1884, reçu deuxième au concours d’admission à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris, il entre à l’atelier d’Alexandre Falguière qui lui enseigne une pratique académique libre. En 1886, Bourdelle loue un modeste atelier où il travaillera jusqu’à son décès, le 1 Octobre 1929.
De 1893 à 1907 Bourdelle bénéficiera de l’aide de Rodin pour lequel il taillera une dizaine de marbres.
Professeur de 1909 à 1929, le sculpteur enseigna plus de cinq cent élèves à l’Académie de la Grande Chaumière à Paris.
 Bourdelle a cinquante ans lorsqu’il connaît le succès grâce à son » Héraklès Archer » exposé au salon de la Société Nationale des Beaux Arts de 1910. Le héros grec bandant son arc pour abattre les oiseaux du lac Stymphale. Il s’agit certainement de la sculpture la plus célèbre de l’artiste. Elle représente l’un des douze travaux de la mythologie grecque, Héraclès condamné par son oncle à défier l’impossible. Son attitude fut rapidement déterminée par le sculpteur soucieux de rendre au mieux la musculature exceptionnelle de son modèle…dont il changea les traits du visage pour préserver son anonymat…Le plâtre présenté au musée est sans doute le plâtre original resté dans l’atelier de l’artiste.
Bourdelle a cinquante ans lorsqu’il connaît le succès grâce à son » Héraklès Archer » exposé au salon de la Société Nationale des Beaux Arts de 1910. Le héros grec bandant son arc pour abattre les oiseaux du lac Stymphale. Il s’agit certainement de la sculpture la plus célèbre de l’artiste. Elle représente l’un des douze travaux de la mythologie grecque, Héraclès condamné par son oncle à défier l’impossible. Son attitude fut rapidement déterminée par le sculpteur soucieux de rendre au mieux la musculature exceptionnelle de son modèle…dont il changea les traits du visage pour préserver son anonymat…Le plâtre présenté au musée est sans doute le plâtre original resté dans l’atelier de l’artiste.
En 1910, le directeur du musée Grevin confie à Bourdelle les décors sculptés du nouveau théâtre sur les Champs Elysées. Il réalise une frise de quinze mètres de long figurant Apollon entouré de neuf muses où il privilégie une conception architecturale et spiritualisée de l’Antique. Pour compléter son programme, il place au dessus de l’entrée cinq bas-reliefs célébrant les ar ts du spectacle et rappelant aux visiteurs la vocation du lieu. On peut admirer les moulages en plâtre patiné des allégories de la danse, de la musique, de la comédie. La dernière figurant l’union de l’architecture et de la sculpture.
ts du spectacle et rappelant aux visiteurs la vocation du lieu. On peut admirer les moulages en plâtre patiné des allégories de la danse, de la musique, de la comédie. La dernière figurant l’union de l’architecture et de la sculpture.
Bourdelle domine la sculpture monumentale, des oeuvres conçues pour habiter l’espace dans lequel elles vont se déployer. Montauban le sollicitera pour l’édification d’un monument aux morts à la mémoire des combattants de la guerre de 1914-1918. Il terminera son projet en 1925. Le musée présente l’étude de la tête de la France, étonnante de puissance géométrique.
Marbres, bronzes, plâtres, maquettes permettent ici de parcourir toute l’oeuvre de l’artiste de ses débuts de jeune sculpteur à Montauban et Toulouse, puis Paris jusqu’à la fin de sa carrière. Mais il serait trop long de les énumérer… Une mention spéciale quand même pour la « Rieuse ».

 Quittons ce lieu mythique pour rejoindre un endroit beaucoup moins culturel, le restaurant « Omnivore » où nous sommes attendus pour manger. Mais qui a dit que la gastronomie ne faisait pas partie du patrimoine culturel ? Quoiqu’il en soit nous faisons dans ce lieu coquet une pause bien méritée. Certains tenteront discrètement, par étourderie ou gourmandise, de « piquer » le plat de leur voisins… Il est déjà l’heure de partir pour Cordes Tolosanes visiter l’ Abbaye de Belleperche, propriété du Conseil Départemental du Tarn et Garonne depuis 1983.
Quittons ce lieu mythique pour rejoindre un endroit beaucoup moins culturel, le restaurant « Omnivore » où nous sommes attendus pour manger. Mais qui a dit que la gastronomie ne faisait pas partie du patrimoine culturel ? Quoiqu’il en soit nous faisons dans ce lieu coquet une pause bien méritée. Certains tenteront discrètement, par étourderie ou gourmandise, de « piquer » le plat de leur voisins… Il est déjà l’heure de partir pour Cordes Tolosanes visiter l’ Abbaye de Belleperche, propriété du Conseil Départemental du Tarn et Garonne depuis 1983.
Fondé en 1130, ce trésor architectural et culturel s’impose en bordure de Garonne. Endommagé par les guerres de religion en 1572, cet ancien palais abbatial a été restauré entre 1604 et 1614 et présente aujourd’hui les restes d’un ancien monastère cistercien, l’un des trois plus riches du Midi où à son apogée vivaient quatre vingt moines : chambres, immenses galeries de desserte, escaliers d’honneur, appartements de réception. On devine que déjà au XVIII° la Haute Société organisait des festins d’un grand raffinement. Nous découvrons le charme et le mystère des vastes salles aux plafonds moulurés. Témoins discrets des personnes un jour passées par là, différentes couches de chaux et de briques traduisent la vaste histoire de l’abbaye.
 Créé en 2002 dans cette majestueuse bâtisse, le Musée des Arts de la table nous plonge dans l’histoire de l’art de vivre de la fin du Moyen Age à nos jours.
Créé en 2002 dans cette majestueuse bâtisse, le Musée des Arts de la table nous plonge dans l’histoire de l’art de vivre de la fin du Moyen Age à nos jours.
 Comment on servait, comment mangeaient nos ancêtres, pourquoi utilise-t-on aujourd’hui couverts et assiettes. Objets de faïence, de porcelaine, verres, ustensiles des plus simples au plus sophistiqués sont exposés dans de nombreuses vitrines… Nous n’en retiendrons que quelques unes.
Comment on servait, comment mangeaient nos ancêtres, pourquoi utilise-t-on aujourd’hui couverts et assiettes. Objets de faïence, de porcelaine, verres, ustensiles des plus simples au plus sophistiqués sont exposés dans de nombreuses vitrines… Nous n’en retiendrons que quelques unes.
Ici, l’art de dresser la table au Moyen Age, la table d’un banquet d’un petit seigneur, de simples planches sur des tréteaux. D’où l’expression, » mettre la table ». Lorsqu’il s’agit de démonter, on « lève « la table. La nappe en lin brodée au fil bleu de motifs d’inspiration orientale est « doublée » d’une longière, une bande de tissus qui court devant les convives et fait office de serviette commune. Quelques objets ornent la table ; trois tranchoirs d’étain attendent les convives.  Chacun y déposera les morceaux de viande détachés des pièces présentées entières. Le découpage sera fait par un serviteur à l’aide d’un couteau à large lame pointue… ou avec les doigts… Parfois une tranche de pain dur sert de tranchoir. Ecuelles, verres et cuillères sont partagés. Les convives sont tous placés du même côté pour profiter de « l’entre-mets », un plat ou un spectacle… La hiérarchie sociale est très respectée : les personnages importants « bénéficient » d’un siège à haut dossier.
Chacun y déposera les morceaux de viande détachés des pièces présentées entières. Le découpage sera fait par un serviteur à l’aide d’un couteau à large lame pointue… ou avec les doigts… Parfois une tranche de pain dur sert de tranchoir. Ecuelles, verres et cuillères sont partagés. Les convives sont tous placés du même côté pour profiter de « l’entre-mets », un plat ou un spectacle… La hiérarchie sociale est très respectée : les personnages importants « bénéficient » d’un siège à haut dossier.
 A partir du XIII°, le poison, en général l’arsenic blanc, indétectable au goût et à l’odeur, est la terreur des grands de ce monde. Afin de déceler sa présence dans un plat ou un gobelet, on utilise des « épreuves », minéraux ou fossiles parés de vertus merveilleuses par croyance religieuse souvent… mais surtout par ignorance de leur nature réelle. Les
A partir du XIII°, le poison, en général l’arsenic blanc, indétectable au goût et à l’odeur, est la terreur des grands de ce monde. Afin de déceler sa présence dans un plat ou un gobelet, on utilise des « épreuves », minéraux ou fossiles parés de vertus merveilleuses par croyance religieuse souvent… mais surtout par ignorance de leur nature réelle. Les  « glossopètres », les langues pétrifiées de serpents maudits par Saint Paul sur l’ile de Malte. Les pierres « crapaudines » prétendument formées dans la tête des crapauds, le corail, le cristal de roche et la corne de licorne qui n’est autre que la dent du narval arctique… C’est également par sécurité que l’on couvre les plats des convives de haut rang . De là vient « le couvert » qui désigne à présent les objets disposés sur la table, fourchettes et cuillères.
« glossopètres », les langues pétrifiées de serpents maudits par Saint Paul sur l’ile de Malte. Les pierres « crapaudines » prétendument formées dans la tête des crapauds, le corail, le cristal de roche et la corne de licorne qui n’est autre que la dent du narval arctique… C’est également par sécurité que l’on couvre les plats des convives de haut rang . De là vient « le couvert » qui désigne à présent les objets disposés sur la table, fourchettes et cuillères.
Pendant la Renaissance, les changements ne sont sensibles que dans les plus hauts niveaux de la société. Les couches bourgeoises et populaires urbaines et rurales gardent des pratiques de repas très simples. Pourtant les goûts, le décor et le mobilier changent. L’orfèvrerie apparaît sur les tables aisées. L’argent remplace l’étain.
 Si au début du XVI° la luxueuse faïence, d’abord italienne, puis française est simplement limitée à l’exposition sur buffets et dressoirs, plats et assiettes en faïence blanche sans décor trouvent leur public en France où plusieurs usines apparaissent à Lyon, Nîmes, Montpellier, Paris et Nevers. En moins d’un siècle, jugée plus propre que le métal, la faïence embellit les tables de l’aristocratie et de la bourgeoisie urbaine. L’assiette prend forme et l’individualisation des objets de table apparaît. Belles salières de cérémonies ou ordinaires en bois. Le verre est d’usage commun : le gobelet à fond plat est remplacé par le verre à jambe et à pied. La vaisselle en grès gagne la faveur de toutes les classes : grès bruns des pays rhénans, grès bleus de Puisaye ou du Beauvaisis, beaux plats décoratifs de Bernard Palissy.
Si au début du XVI° la luxueuse faïence, d’abord italienne, puis française est simplement limitée à l’exposition sur buffets et dressoirs, plats et assiettes en faïence blanche sans décor trouvent leur public en France où plusieurs usines apparaissent à Lyon, Nîmes, Montpellier, Paris et Nevers. En moins d’un siècle, jugée plus propre que le métal, la faïence embellit les tables de l’aristocratie et de la bourgeoisie urbaine. L’assiette prend forme et l’individualisation des objets de table apparaît. Belles salières de cérémonies ou ordinaires en bois. Le verre est d’usage commun : le gobelet à fond plat est remplacé par le verre à jambe et à pied. La vaisselle en grès gagne la faveur de toutes les classes : grès bruns des pays rhénans, grès bleus de Puisaye ou du Beauvaisis, beaux plats décoratifs de Bernard Palissy.
La seconde moitié du XVII° marque le début du service « à la française ». Les convives occupent désormais les quatre côtés de la table. La notion de service de vaisselle aux éléments coordonnés par le décor ou par un coloris dominant émerge. Désormais la succession des mets est regroupée par catégories, potages, entrées puis rôtis et salades et, enfin, le dessert appelé « fruit ». C’est aussi l’apparition de l’art de faire le café, cette noire liqueur venue de Turquie que la France découvre peu après le chocolat et le thé. On le connaît à Marseille dès 1660 mais il faudra attendre 1669 et la réception à Paris de l’ambassade turque conduite par Soliman Aga pour voir la consommation du café s’installer dans la haute bourgeoisie parisienne. Il se démocratisera à la fin du XVIII°. Il est vrai que la méthode de préparation à la turque n’est pas vraiment faite pour donner aux consommateurs une idée raffinée du café : bouilli, remué,…clarifié, décanté… puis réchauffé… Grimod de la Reynerie avait sûrement raison quand il disait « que le café n’est qu’une décoction plus ou moins colorée »… Le café plongé dans l’eau grâce à une « chausse » ne valait guère mieux. » Ce jus de chaussette » n’est lui aussi qu’un café clair et médiocre. Lorsque l’Europe découvre le café dans les années 1660, il n’y a aucun objet de préparation et de service adapté. Les cafetières apparaissent vers 1670, les premières tasses à anses seront créées au début du XVIII°. Ce n’est qu’en 1802 qu’un pharmacien dieppois, Descroizilles invente la cafetière à filtre. On peut alors apprécier « le café sans ébullition, une invention nouvelle et précieuse »…
Au XIX°, le  service à la française s’oppose au service à la russe. » On y trouve le moyen de satisfaire son goût du paraître tout en dépensant moins » : le service à la russe imposant une présentation des plats en séquence exige moins d’apparat. Mais il faut reconnaître que leur dualité a exercé une influence directe dans l’histoire des arts de la table : les usages ont évolué, ainsi que la cuisine et la gastronomie en général.
service à la française s’oppose au service à la russe. » On y trouve le moyen de satisfaire son goût du paraître tout en dépensant moins » : le service à la russe imposant une présentation des plats en séquence exige moins d’apparat. Mais il faut reconnaître que leur dualité a exercé une influence directe dans l’histoire des arts de la table : les usages ont évolué, ainsi que la cuisine et la gastronomie en général.
Durant la visite quelques curiosités du XVIII° ont attiré notre attention.
Des couverts dressés à l’envers sur l’une des tables, « copie » d’une table dressée au XVIII°: subterfuge pour forcer l’utilisateur des couverts à les retourner et donc à regarder les armoiries ou les initiales du propriétaire gravées sur les spatules des fourchettes et cuillères…
La marronnière, une fine faïence où les marrons étaient bouillis ou cuits à l’étouffée.
Une jatte d’olives en trompe l’oeil… les trompe l’oeil, « les attrapes » en forme de plat ou d’assiettes garnis de fruits frais ou secs décoraient la table et divertissaient les convives qui attendaient de voir l’un d’eux , trompés par la faible luminosité des chandelles, prendre pour véritable un fruit en faïence et tenter en vain de le saisir.
 Une dernière annotation pour un porte ananas en cristal. Fruit exotique importé, l’ananas est longtemps resté le fruit le plus cher. Dans la première moitié du XIX°, le bon goût et la mode prescrivent de présenter un ananas en décoration… A l’occasion d’un repas, il était recommandé de louer un ananas chez un marchand pour le déposer sur un socle mis en évidence sur un meuble ou une table…et l’ananas repartait ensuite chez le loueur…
Une dernière annotation pour un porte ananas en cristal. Fruit exotique importé, l’ananas est longtemps resté le fruit le plus cher. Dans la première moitié du XIX°, le bon goût et la mode prescrivent de présenter un ananas en décoration… A l’occasion d’un repas, il était recommandé de louer un ananas chez un marchand pour le déposer sur un socle mis en évidence sur un meuble ou une table…et l’ananas repartait ensuite chez le loueur…
Bien que ce soit la plus grande collection en Occident de théières en grès du Yixing, nous ne nous attarderons pas devant cette exposition et préférons admirer l’architecture de l’ancien cloître.
Nous quittons à regret ce lieu emblématique et regagnons nos logis auscitains. L’heure du dîner approche… Mais, après notre immersion à Belleperche, dresser correctement la table semble moins évident…Verres, couverts et assiettes seront-ils en harmonie? Soyons fins stratèges! Serait-ce un sacrilège d’adapter à la gastronomie la citation d’Alfred de Musset ? :
« Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse ».
CH D
Galerie Musée Ingres Bourdelle :
Galerie Abbaye de Belleperche :
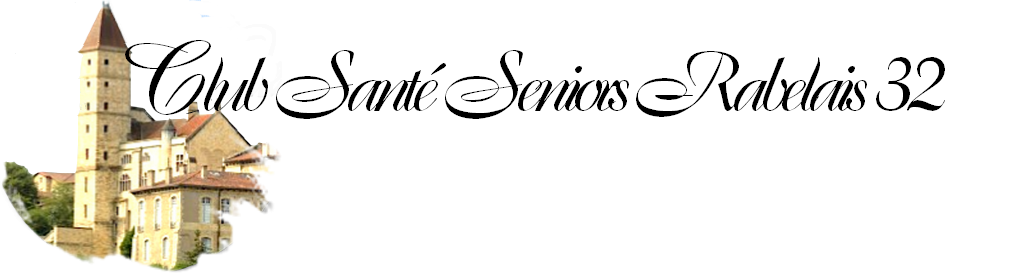


Laisser un commentaire